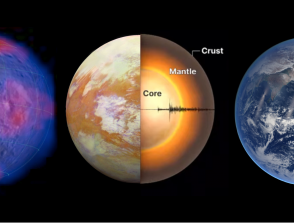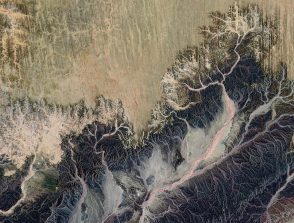Venus-Earth Atmospheric Monitoring for Seismology
Début : 01/06/2021 - Fin : 31/08/2025
Coordinateurs : Philippe Lognonné, Pierre Simoneau
Établissements porteurs :
Institut de physique du globe de Paris
Établissements partenaires :
ONERA
Équipes liées :
Planétologie et sciences spatiales
Thèmes liés :
Intérieurs de la Terre et des planètes, Système Terre