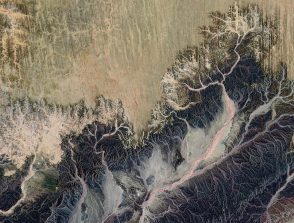Détection et suivi de grandes baleines par mesures hydroacoustiques et sismologiques. Apport des mesures en fond de mer et dans le canal SOFAR
13/11/2025
IPGP - Îlot Cuvier
14:00
Soutenances de thèses
Amphithéâtre
Richard Dreo
Géosciences marines (LGM)
Depuis plusieurs décennies, des sismomètres de fond de mer (Ocean Bottom Seismometers, ou OBS) et des enregistreurs acoustiques autonomes positionnés dans le SOFAR sont déployés dans l’ensemble des océans afin de mener des études de géophysique. Une grande quantité de données sismiques et hydroacoustiques issues de ces instruments est aujourd’hui en accès libre en ligne. Ces données offrent une opportunité exceptionnelle pour le suivi par acoustique passive des grandes baleines à fanons, qui émettent des vocalisations dans les ultra‑basses fréquences (UBF) (< 50‑100 Hz). Pour exploiter ce potentiel, il est nécessaire de développer des méthodes rapides et robustes capables de traiter ces jeux de données massifs, souvent acquis pendant plusieurs mois, afin de détecter, localiser et dénombrer les passages d’individus. Ces étapes sont essentielles pour estimer les distributions saisonnières, analyser les comportements locaux et évaluer la densité de population des différentes espèces, toutes poussées au bord de l’extinction par la chasse industrielle au cours du XIXᵉ et XXᵉ siècle, et à ce jour encore impactées par les activités humaines.
La méthode de détection de baleines développée ici permet d’évaluer rapidement leur présence grâce aux chants stéréotypés cadencés qu’elles émettent dans l’UBF. Son originalité réside dans le fait qu’elle s’appuie exclusivement sur la recherche du rythme du chant, sans tenter d’identifier la vocalisation elle‑même, permettant une analyse rapide de gros volumes de données. Appliquée aux six années de données multi‑sites du réseau de surveillance sismique REVOSIMA, situé à l’est de Mayotte (Canal du Mozambique, Océan Indien), elle a permis de caractériser les distributions saisonnières de quatre espèces : la baleine bleue antarctique (Balaenoptera musculus interdermedia), la baleine bleue pygmée du sud‑ouest de l’océan Indien (Balaenoptera musculus brevicauda), la baleine de minke antarctique (Balaenoptera bonaerensis) et le rorqual commun (Balaenoptera physalus). Sa capacité à extraire les intervalles inter‑cris (ICI) sur de longues périodes en fait un outil d’étude adapté aux recherches futures portant sur l’évolution des ICI à grande échelle.
La méthode de suivi de trajectoire exploite la capacité des capteurs vectoriels (acoustiques ou sismiques) à indiquer la direction d’arrivée des ondes acoustiques incidentes, ainsi que leur sensibilité à la propagation multi‑trajets. Ces deux propriétés permettent d’estimer respectivement l’azimut et la distance de la source. En adaptant une méthode initialement développée pour le suivi de navires avec un capteur acoustique vectoriel, il devient possible de suivre les déplacements de baleines sur plusieurs dizaines de kilomètres à partir d’un seul OBS.
Sur cette base, un simple suivi en azimut permet d’estimer le nombre de passages d’individus détectés par un unique OBS. Appliquée au réseau REVOSIMA pour trois espèces (baleine bleue antarctique, baleine bleue pygmée du sud‑ouest de l’océan Indien et rorqual commun), cette approche a permis d’évaluer le nombre de passages saisonniers sur plusieurs années. Elle révèle une présence nettement plus marquée des baleines bleues pygmées comparée aux baleines bleues antarctiques et aux rorquals communs. Elle apporte également, pour la première fois à partir de données mono‑OBS, une visualisation directe des routes migratoires saisonnières.
Pour que ce suivi en azimuts soit possible, il est nécessaire de connaître l’orientation des OBS. Deux méthodes originales sont proposées dans ce travail pour orienter simultanément un réseau d’OBS à partir d’une même source de position inconnue, en l’absence de source de référence. Ainsi, l’observation d’un même navire par tous les capteurs du réseau suffit pour obtenir des orientations fiables.
Ces travaux, qui visent une exploitation systématique des grands jeux de données OBS et hydroacoustiques, contribuent à améliorer la connaissance des grandes baleines. À l’échelle globale, ces méthodes aideront à mieux comprendre leurs migrations et à évaluer plus précisément l’état des populations.