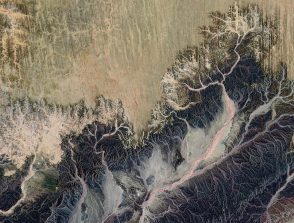Architecture et dynamique du système magmatique du Fani Maoré : apports des modèles numériques
04/12/2025
IPGP - Îlot Cuvier
10:00
Soutenances de thèses
Amphithéâtre
Clément de Sagazan
Géosciences marines (LGM)
Cette thèse étudie l’architecture et la dynamique du système magmatique alimentant le volcan Fani Maoré au large de Mayotte. Mayotte a connu du volcanisme du Miocène au Quaternaire, mais pas au cours des temps historiques, et la sismicité avant 2018 était modérée. La mise en place entre 2018 et 2020 d’un nouveau volcan sous-marin, Fani Maoré, à 50 km au large de l’île, a révélé la présence d’un système magmatique actif alors inconnu. Depuis 2018, des observations sismiques, géophysiques, géochimiques et pétrologiques ont permis de contraindre l’architecture et les dimensions de ce système de plomberie magmatique. Cependant, en raison d’une instrumentation initialement faible, ces observations sont soumises à d’importantes incertitudes. La thèse a visé, par la modélisation numérique, à mieux caractériser le système d’alimentation du Fani Maoré.
Les foyers sismiques au large de Mayotte sont répartis en deux essaims. L’essaim "distal", situé entre 30 et 50 km à l’est de Mayotte, est apparu en premier. Il marque la présence d’un dyke par lequel le magma est remonté vers le plancher océanique depuis 40 km de profondeur. Plus tard est apparu un essaim "proximal", plus proche de Mayotte (10 km à l’est). Cet essaim est compris entre 40 et 25 km de profondeur. En plus de la sismicité, Mayotte a connu une subsidence vers l’est d’environ 20 cm sur l’ensemble de l’éruption. Les déplacements peuvent être expliqués par une source de déflation à 40 km de profondeur au sein de l’essaim distal.
La thèse s’est d’abord concentrée sur l’essaim proximal. La forme conique de ce dernier évoque celle des essaims sismiques associés aux effondrements de caldera, mais ici la sismicité demeure loin du plancher océanique. Une étude tomographique a montré que l’essaim pourrait résulter de l’interaction mécanique de deux réservoirs superposés. J’ai utilisé COMSOL Multiphysics pour produire des modèles 2D axisymétriques de réservoirs ellipsoïdaux en domaine élasto-plastique. J’ai ainsi exploré sous quelles conditions la distribution de la sismicité peut être reproduite par la distribution de la fracturation dans les modèles. J’ai montré qu’une zone de faille conique peut se développer entre les réservoirs quand l’un des deux est pressurisé et l’autre est dépressurisé. Ceci signifie que, si l’essentiel du magma a été évacué vers Fani Maoré, une partie a pu migrer vers le haut pour remplir un réservoir à 20-25 km de profondeur proche de l’île.
Ensuite, j’ai réalisé des modèles 2D en repère cartésien avec COMSOL, en ajoutant un troisième réservoir à l’est. En effet, des modèles restreints à la zone proximale ne peuvent reproduire fidèlement les déplacements GNSS, dont l’inversion détermine une source de déflation située dans la zone distale. L’ajout d’une source de déflation à l’est du système à deux réservoirs de la zone proximale reproduit mieux l’orientation des déplacements de surface, tout en conservant la forme conique de l’essaim proximal.
Enfin, je me suis penché sur la mise en place de l’essaim distal entre mai et juin 2018. En effet, cet essaim a marqué la migration du magma de 40 km de profondeur jusqu’au plancher océanique en une quarantaine de jours. En utilisant un code simulant une propagation de dyke dans un milieu élastique, j’ai montré que le temps d’ascension du magma résulte d’un compromis entre les dimensions du dyke et la résistance du milieu à la fracturation. Le temps de remontée des dykes modélisés dépend essentiellement de la viscosité. En milieu homogène, les dykes modélisés semblent trop rapides pour reproduire l’ascension du magma sous Fani Maoré, à moins de surestimer la viscosité du magma. D’autre part, l’introduction d’un contraste de densité et de résistance à la fracture (représentant le Moho) arrête la propagation du dyke. Il semble donc que la remontée du magma se soit faite en plusieurs étapes : une remontée jusqu'au Moho, une phase de stagnation, puis une reprise de la remontée jusqu'à l'éruption.