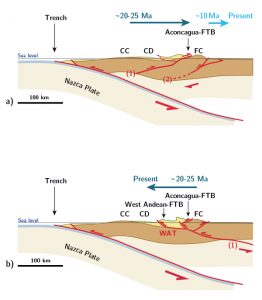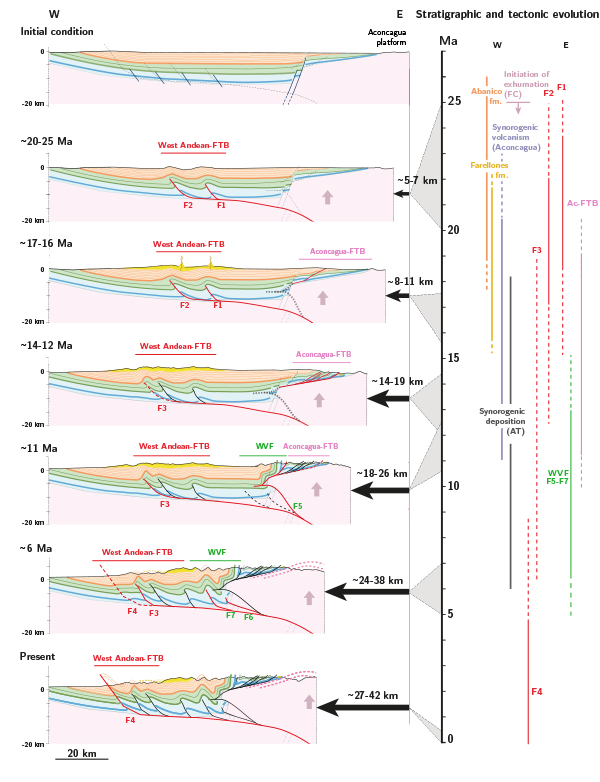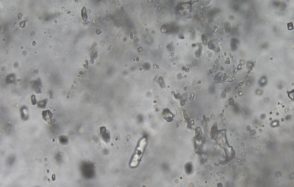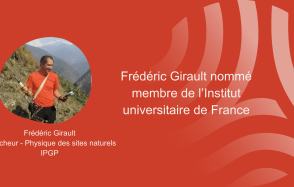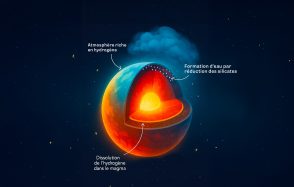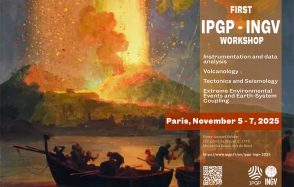La structure crustale et la cinématique des Andes centrales revisitée
Depuis l'avènement de la tectonique des plaques, on distingue les chaînes de montagnes dues à la collision de blocs continentaux, dont l'exemple type est l'Himalaya et celles qui sont liées à la subduction d'une plaque océanique en bordure d'un continent telles que les Andes.
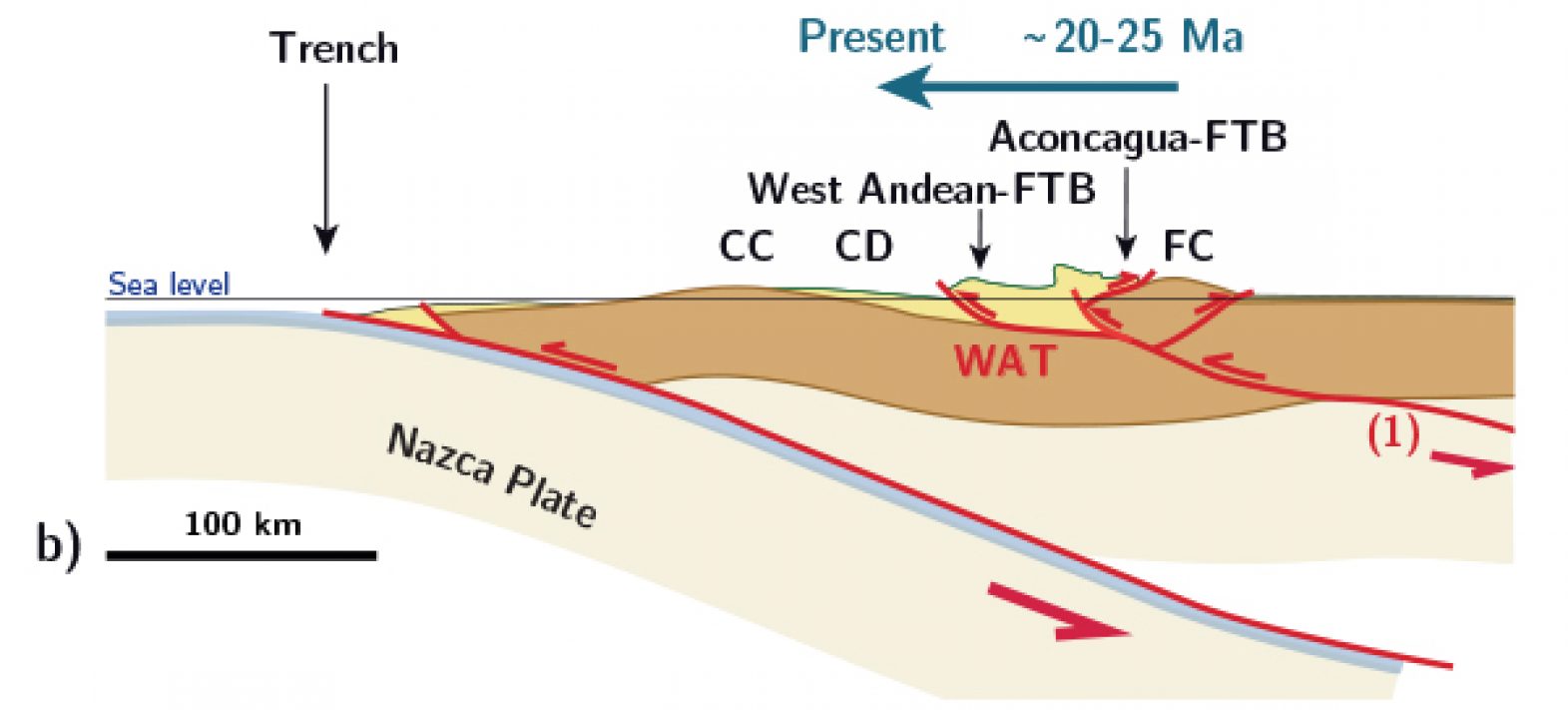
Date de publication : 15/05/2018
Grand Public, Presse, Recherche
Équipes liées :
Tectonique et mécanique de la lithosphère
Thèmes liés : Système Terre